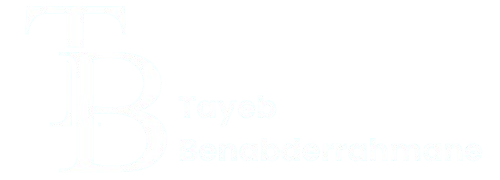Une affaire au croisement du droit pénal, international et diplomatique
L’affaire Tayeb Benabderrahmane illustre la collision entre le droit, la politique et la diplomatie internationale.
Ce chef d’entreprise franco-algérien, arrêté et torturé au Qatar, a été condamné à mort par contumace à l’issue d’une procédure jugée illégale par plusieurs instances internationales.
Mais au-delà de son destin personnel, cette affaire soulève des questions fondamentales sur le respect du droit international, la protection des ressortissants français à l’étranger, et la responsabilité des États face aux violations des droits humains.
Un déni de justice en violation du droit qatari
Selon les documents judiciaires et diplomatiques, Tayeb Benabderrahmane a été arrêté le 13 janvier 2020 sans mandat, détenu dans un lieu secret pendant plusieurs mois, puis contraint à signer un protocole sous la menace.
Ces faits violent non seulement le Code de procédure pénale du Qatar, mais aussi plusieurs articles de la Constitution qatarienne, notamment :
-
Article 35 : interdiction de la torture et du traitement dégradant ;
-
Article 36 : protection de la liberté individuelle ;
-
Article 39 : droit à un procès équitable et public.
Malgré ces garanties, Tayeb Benabderrahmane a été privé d’avocat, de communication avec sa famille et de toute procédure contradictoire, avant d’être condamné en secret à la peine capitale.
Une violation manifeste du droit international
Les conventions internationales bafouées
Les faits rapportés contre le Qatar constituent des violations graves de plusieurs instruments juridiques internationaux :
-
Convention contre la torture (1984) : ratifiée par le Qatar en 2000, elle interdit tout acte de torture ou traitement inhumain ;
-
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : ratifié par Doha en 2018, il garantit le droit à un procès équitable et à la liberté ;
-
Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) : elle impose aux États d’informer sans délai les autorités consulaires lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté ;
-
Charte arabe des droits de l’homme (2009) : adoptée par le Qatar, elle interdit explicitement la détention arbitraire.
Le traité bilatéral France–Qatar de 2006
Un accord signé en 2006 entre la France et le Qatar sur la coopération judiciaire prévoit une assistance mutuelle en matière pénale.
Pourtant, aucune demande d’entraide n’a été formulée par Doha avant la condamnation de Tayeb Benabderrahmane — une violation claire du traité.
La compétence des juridictions françaises
L’article 113-7 du Code pénal français prévoit la compétence des tribunaux français pour juger les crimes commis à l’étranger lorsque la victime est de nationalité française.
Or, Tayeb Benabderrahmane étant citoyen français, la France avait toute légitimité pour ouvrir une enquête sur sa séquestration et sa torture.
C’est ce qu’elle a fini par faire :
le 27 février 2023, trois juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ont été désignés pour enquêter sur les faits d’enlèvement et de torture visant Nasser Al-Khelaïfi et d’autres responsables qataris.
Mais le délai entre les faits (2020) et cette ouverture d’enquête (2023) témoigne d’une inertie diplomatique préoccupante, contraire au devoir de protection des ressortissants.
Le rôle du CIRDI – Tribunal arbitral de la Banque mondiale
Face à l’inaction diplomatique française, les avocats de Tayeb Benabderrahmane ont saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), basé à Washington.
Ce tribunal arbitral est compétent pour les litiges entre un investisseur étranger et un État.
L’affaire, enregistrée sous le numéro ARB/22/23, oppose Tayeb Benabderrahmane au Qatar pour violation du traité bilatéral d’investissement signé en 1996 entre les deux pays.
Les ordonnances du tribunal arbitral
-
Ordonnance n°3 (octobre 2023) : le tribunal exige la production des documents relatifs à la détention de Tayeb Benabderrahmane.
-
Ordonnance n°7 (juillet 2024) : le Qatar est de nouveau sommé de produire les pièces judiciaires et diplomatiques liées à sa condamnation.
Le Qatar refuse à deux reprises, démontrant un mépris total pour la justice internationale.
Cette absence de coopération renforce la thèse d’un dossier falsifié et d’une procédure politique.
L’intervention des Nations Unies
L’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire
En août 2025, le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU rend un avis décisif :
“La détention de M. Tayeb Benabderrahmane est arbitraire, illégale et contraire aux obligations internationales du Qatar.”
Le rapport conclut que :
-
Le procès a été tenu en secret ;
-
Les preuves ont été fabriquées ;
-
Les aveux ont été obtenus sous la torture ;
-
Et la condamnation à mort est nulle et non avenue.
Une condamnation politique dissimulée
Le rapport des Nations Unies révèle que la condamnation de Tayeb Benabderrahmane est intervenue neuf jours seulement après l’ouverture d’une enquête judiciaire en France visant Nasser Al-Khelaïfi.
Une chronologie qui prouve que le procès qatari n’avait qu’un but : intimider et discréditer un témoin gênant.
Les responsabilités diplomatiques françaises
Le rôle du ministère français des Affaires étrangères dans cette affaire est désormais au centre des débats.
Plusieurs courriers officiels — révélés par le média Blast — montrent que le Quai d’Orsay était informé de la séquestration de Tayeb dès mars 2020.
Malgré cela, aucune mesure consulaire ni diplomatique n’a été engagée pour le protéger.
Ce manquement pourrait engager la responsabilité de l’État français pour :
-
Non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) ;
-
Abstention volontaire d’empêcher une infraction (article 223-7) ;
-
Et manquement au devoir de protection consulaire.
Les enjeux juridiques actuels
En France
L’instruction ouverte à Paris se poursuit.
Les perquisitions menées en juin et juillet 2023 dans les locaux du PSG, à la mairie du 7ᵉ arrondissement et dans plusieurs cabinets d’avocats, confirment que les juges d’instruction suivent la piste d’une collusion organisée entre responsables qataris et intermédiaires français.
À l’international
Le CIRDI poursuit son analyse du dossier, tandis que plusieurs ONG demandent à l’Union européenne de geler les accords de coopération judiciaire avec le Qatar tant que les violations du droit international perdurent.
À l’ONU
Les instances onusiennes préparent une résolution spécifique sur la détention arbitraire visant à sanctionner les États récidivistes, dont le Qatar figure désormais en tête de liste.
Les conséquences géopolitiques de l’affaire
L’affaire Tayeb Benabderrahmane met en lumière une tension croissante entre le respect des droits humains et les intérêts économiques de la France au Moyen-Orient.
Doha, allié stratégique dans les domaines de l’énergie et du sport, se retrouve désormais isolé sur la scène diplomatique.
Pour la France, cette affaire pose une question fondamentale :
Peut-on continuer à coopérer avec un État accusé de torture et de falsification judiciaire sans compromettre sa propre crédibilité internationale ?
Une affaire qui fera jurisprudence
L’affaire Tayeb Benabderrahmane pourrait devenir un cas d’école en droit international.
Elle interpelle directement les Nations Unies, l’Union européenne et les tribunaux arbitraux sur la nécessité de renforcer la protection des citoyens face aux abus d’État.
Elle démontre aussi que le droit ne peut être dissocié de la morale et de la responsabilité politique.
Si les institutions internationales parviennent à condamner définitivement le Qatar, cette affaire pourrait faire évoluer la jurisprudence mondiale en matière de détention arbitraire et de torture d’État.
Vers un espoir de justice
Aujourd’hui, Tayeb Benabderrahmane poursuit son combat pour obtenir justice, vérité et reconnaissance.
Grâce à la mobilisation de ses avocats, des ONG et des médias, son cas est devenu un symbole de résistance face à l’impunité diplomatique.
Son dossier, désormais entre les mains de juridictions internationales, incarne la lutte d’un homme — mais aussi celle de tout un système judiciaire mondial — contre les dérives du pouvoir absolu.